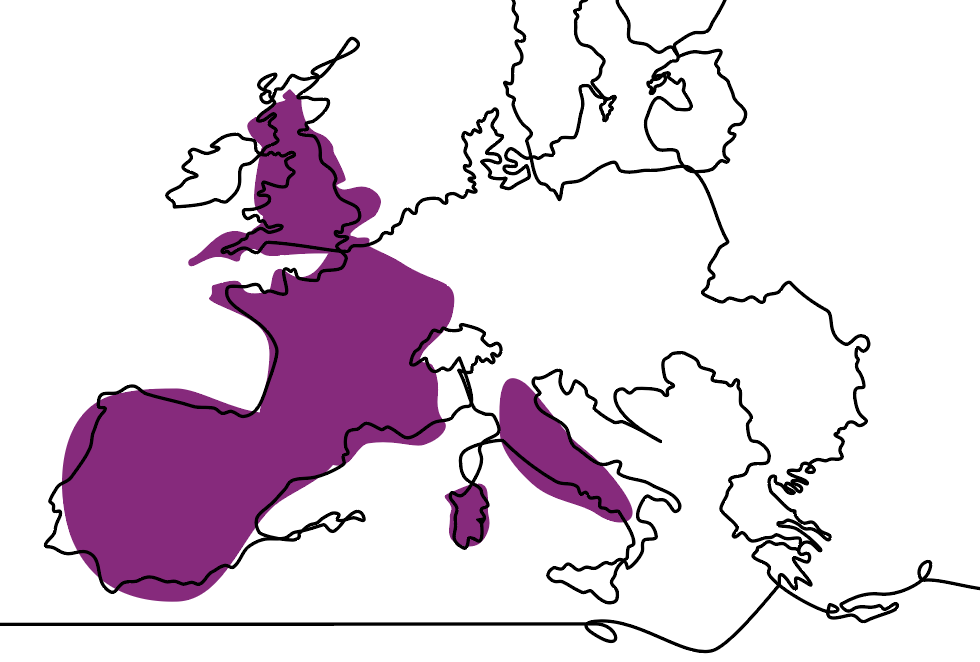Dans le monde professionnel, les notions de contrôle et de confiance sont souvent perçues comme opposées. Pourtant, loin d’être incompatibles, elles peuvent coexister de manière complémentaire et créer un levier de performance durable. Comprendre cette articulation est essentiel pour les managers d’aujourd’hui.
Et surtout indispensable avec les défis actuels é à venir pour optimiser son fonctionnement humain & rentable
Le contrôle & confiance managériale : de quoi parle t’on ?
Le contrôle managérial où la nécessité d’organiser & de piloter :
L’ensemble des dispositifs mis en place pour s’assurer que les actions des collaborateurs sont alignées sur les objectifs de l’organisation permet de réduire l’incertitude, assurer la qualité, prévenir les dérives, et garantir la bonne utilisation des ressources. Il constitue un pilier de la gouvernance et il est donc indispensable. Il est constitué du
- Contrôle managérial Formel : procédures, indicateurs de performance, audits, reporting.
- Contrôle managérial Informel : culture d’entreprise, normes sociales, observation comportementale.
La confiance en management où l’indispensable autonomie, catalyseur de la performance :
Sur le principe même que la performance repose sur l’efficacité du système, la confiance donnée aux équipes passent nécessairement par l’autonomie laissée. Elle repose bien sur, sur la conviction que l’autre agira de manière loyale, compétente et responsable. Elle permet notamment :
- De favoriser la prise d’initiative
- D’accélérer la prise de décision en réduisant notamment les vérifications,
- De renforcer l’engagement des équipes et laisser le droit à l’erreur
- De réduire les coûts de fonctionnement et la complexité des procédures.
Une relation de confiance bien établie a un effet multiplicateur sur la motivation et la collaboration. D’autant plus vrai si elle permet de remettre en cause les schémas de contrôle inutiles ou inefficaces (à cadrer sur le périmètre)
Contrôle vs confiance : Véritable ou faux dilemme managérial
Il est tentant d’opposer ces deux concepts : contrôler reviendrait à ne pas faire confiance, tandis que faire confiance impliquerait de renoncer au contrôle. En réalité, le management efficace repose sur un dosage subtil entre ces deux logiques. Les 2 sont indispensable pour une relation manager-managé équilibré : management rassurant et management développant, et indispensable aussi pour une organisation efficiente. Jocko appelle ca la dichotomie, un des piliers du leadership selon cet ancien marines : https://jocko.com/books/
Contrôle et confiance managériale : équilibrer en 3 clefs
Un équilibre confiance / contrôle qui se structure :
- Adopter un contrôle intelligent : orienté sur les résultats, souple, évolutif, et non intrusif, basé sur la motivation & la compétence
- Construire un climat de confiance par la transparence, la reconnaissance et la cohérence des actes managériaux.
- Adapter le niveau de contrôle au contexte : un collaborateur expérimenté ou une équipe soudée nécessite moins de supervision qu’une nouvelle recrue.
Le rôle du manager : chef d’orchestre de l’équilibre
Le manager joue un rôle essentiel dans la régulation de ce tandem confiance vs contrôle, Il est important :
- Instaurer des cadres clairs et sécurisants dans son management
- Démontrer sa propre fiabilité pour susciter la réciprocité, & faire preuve d’exemplarité, une valeur indispensable dans son management
- Savoir lâcher prise lorsque la situation le permet, sans perdre de vue les objectifs.
Un manager qui contrôle sans confiance crée un climat de suspicion ; un manager qui fait confiance sans contrôle prend des risques inconsidérés. L’efficacité se trouve dans l’alignement des intentions et des dispositifs.
Conclusion : vers un management de la maturité
Contrôle et confiance ne s’excluent pas, ils se renforcent mutuellement lorsqu’ils sont bien équilibrés. Un contrôle bienveillant dans son pilotage managérial renforce la confiance, et une confiance active bien positionné rend le contrôle plus léger et plus efficace. Le manager moderne est appelé à dépasser l’opposition binaire pour adopter cette posture de maturité managériale, fondée sur l’observation, l’ajustement et la responsabilisation.